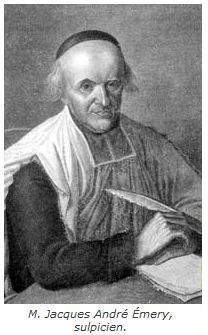La Compagnie de Saint-Sulpice au cœur de la tourmente révolutionnaire
Depuis 1782, le supérieur général de la Compagnie de Saint-Sulpice, était M. Emery, moraliste et juriste de formation, il avait su réformer le Grand Séminaire de Paris, les efforts de ses prédécesseurs ayant toujours été vains. La force de son tempérament et une ascèse de vie rigoureuse, liés à une capacité peu banale de savoir parfaitement distinguer les plans, lui permettaient d’avoir vis-à-vis de ses interlocuteurs, autorité et ascendant. Très rapidement il a perçu les dangers de la Constitution Civile du Clergé, votée le 12 juillet 1790 et sanctionnée par Louis XVI le 24 août de la même année. Il y voyait un risque évident de division de l’Eglise, avec le triomphe des idées gallicanes et jansénistes. Selon lui, le principe d’attachement à l’évêque de Rome, prôné par M. Olier, ne pouvait être remis en question. Ce principe devait être bien ancré chez les messieurs de S. Sulpice, car M. Emery se félicite quelques mois plus tard qu’aucun membre de la Compagnie n’est prononcé le serment d’allégeance à la Constitution Civile.
18 sulpiciens meurent martyrs surtout dans la période noire de 1792 : deux directeurs du séminaire d’Avignon, lynchés dans le village des Vans, diocèse de Viviers, fin juillet ; trois massacrés à Conches dans le diocèse d’Autun le 26 août ; puis huit au sein des martyrs des Carmes, le 2 septembre ; dans la nuit du 9 au 10 décembre, un directeur du séminaire de Nantes subit le triste sort des ingéniosités de Carrier. Un autre directeur est guillotiné à Paris le 25 février 1794 ; début juin de la même année, deux autres sulpiciens meurent sur les pontons de Rochefort ; le dernier de la liste enfin est passé par les armes durant les Guerres de Vendée. M. Emery lui-même échappe de peu à la guillotine, sans doute grâce à des appuis dans le milieu de la Montagne.
Sur un autre plan, la dispersion des prêtres de Saint Sulpice, du fait de la fermeture des séminaires surtout pendant l’année 1791, donne des résultats souvent surprenants. Si certains repartent dans leur diocèse vivant dans des conditions parfois difficiles, mais tachant de monter des séminaires clandestins, d’autres préfèrent la route de l’émigration. Plusieurs directions : l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne ou encore l’Angleterre. Ainsi en Franconie, le prince de Hohenlohe met un de ses châteaux à la disposition des sulpiciens émigrés, ne tardant pas à fonder un séminaire qui devient un lieu culturel et religieux estimé. Il en est de même en Espagne à Orense, où l’évêque songe même à demander à Saint-Sulpice de prendre en main son séminaire. Le projet n’a pas de suite. En Angleterre, à Londres, un petit groupe de sulpiciens parvient à faire bâtir une chapelle sous le vocable de l’Annonciation, et la qualité de vie de prière et de relations ne tardent pas à faire évoluer l’avis de certains anglicans sur les « papistes ».
Cette « redistribution » permet aussi de consolider les fondations américaines. Le séminaire de Montréal vivotait et menaçait de disparaître, suite aux vexations et autres procédés juridiques du gouvernement anglais. Finalement, pendant la période révolutionnaire, ce sont dix-huit sulpiciens français qui arrivent à Montréal, permettant une vraie résurrection, sous la férule de M. Roux, lui aussi moraliste et juriste, mais d’un tempérament plus nerveux et plus explosif que M. Emery.
A peu près dans le même temps, le premier évêque catholique américain, Mgr Carroll, demande à M. Emery en août 1790, la possibilité que des sulpiciens viennent fonder un séminaire à Baltimore. Le supérieur général y voit un signe providentiel et délègue quatre membres de la Compagnie pour commencer une expérience de formation des prêtres outre-Atlantique. Au plus fort de l’angoisse, en avril 1794, du fond de la Conciergerie, M. Emery écrit une lettre testament à M. Nagot, supérieur de Baltimore, disant en substance, que si la Compagnie s’éteint en France, elle pourrait repartir des Etats-Unis. L’histoire en jugera autrement.
 Mgr John Carroll, premier évêque de Baltimore et des USA
Mgr John Carroll, premier évêque de Baltimore et des USA
Au lendemain de la Révolution Française.
Dès la signature du Concordat la tâche se révèle énorme et immense aux quelques sulpiciens groupés autour de M. Emery. Ce sont les mêmes qu’avant 1789 avec quelques années de plus… La reprise de la vie à Saint-Sulpice connaît deux étapes : de 1801 à 1810, date à laquelle Napoléon décide la suppression de la Compagnie ; puis à partir de 1814, le roi Louis XVIII admettant Saint-Sulpice à reprendre son rôle de formation dans certains séminaires.
Bonaparte, premier consul, avait tenu à ce que toute la formation ait lieu en un même endroit, afin d’éviter les déplacements dans les villes, surtout d’étudiants, toujours propices à quelque risque de perturbation ou de soulèvement. La formation intellectuelle n’a donc plus lieu dans les facultés de théologie, mais elle est dispensée dans les séminaires mêmes.
D’autre part, Bonaparte préférait « rétablir » le clergé diocésain, plus facile à contrôler que les ordres religieux. Du fait de leur statut de prêtre diocésain, les sulpiciens pouvaient reprendre leur fonction dans certains séminaires. Il faut aussi ajouter que l’oncle même de Bonaparte, Joseph Fesch, promu pour la circonstance archevêque de Lyon, avait été réconcilié avec l’Eglise catholique romaine par M. Emery lui-même. Certains historiens rappellent que Bonaparte était impressionné par celui qu’il appelait : « le petit prêtre ». Pour cette raison, les sulpiciens retrouvent les séminaires qu’ils dirigeaient avant la Révolution, mais de nouveaux leur sont confiés, souvent par des évêques anciens élèves de Saint-Sulpice. L’exemple le plus significatif étant celui de Bordeaux où Mgr d’Aviau, ancien séminariste à Lyon, impose pratiquement à M. Emery, la décision de confier à Saint-Sulpice son séminaire.

Seulement cet élan a ses limites. Le nombre de formateurs est largement insuffisant. Dans un premier temps, beaucoup de directeurs et surtout de supérieurs, restent un longtemps dans le même séminaire, cette tendance ne s’inverse qu’au milieu du 19ème siècle. Le record de longévité est battu par M. Ducray, supérieur de Toulouse de 1819 à 1863.
Autre question : la formation elle-même. La plupart du temps, les directeurs reprennent les manuels du siècle précédent. La capacité d’adaptation est assez faible. Le plus important est l’enseignement de la Morale confié à un directeur expérimenté ; des rapports de visites canoniques n’hésitent pas à dire qu’aux jeunes directeurs, il vaut mieux leur confier l’Ecriture Sainte… Quant à la formation spirituelle, elle ne reprend pas les intuitions d’Olier, loin de là ; ce sont les exercices de M. Tronson qui restent la référence majeure. Le sentiment religieux qui domine le plus souvent est celui de la « revanche spirituelle », les directeurs sont invités à prêcher le repentir, les sacrifices d’expiation, la consolation, une dévotion plus doloriste du Sacré-Cœur, en réparation des exactions, profanations et sacrilèges des temps révolutionnaires. Ces dispositions multiplient les prières et exercices de piété, les cahiers de directeurs de cette époque manifestent moins d’insistance sur l’oraison et la recherche d’un chemin intérieur d’union avec le Christ.
Mais il ne faudrait pas croire que ce type de formation n’ait pas porté de fruit conséquent. Au contraire, il semble qu’il ait été parfaitement adapté à ce que le Concordat de 1801 avait dessiné quant à ce que nous pourrions appeler la « carte cléricale ». Le curé devenait avec le notaire, le maire et le médecin, l’un des notables de village ; la formation préparait les prêtres à assumer ce rôle du mieux possible, dans ce moment que les historiens ont appelé la reprise de « l’ordre moral ». Par rapport au siècle précédent, il est certain que le niveau général de la moralité et de la qualité intellectuelle du clergé français s’est considérablement amélioré.
Un autre point qu’il convient de souligner : beaucoup de prêtres jouent un rôle dans la fondation de congrégations féminines pour l’éducation des enfants ou les soins portés aux malades. Il est frappant de constater que ces prêtres, reprennent la plupart du temps les intuitions fondamentales de l’Ecole Française. Nous donnons deux exemples : la fondation en 1818 à Toulouse de la Congrégation des sœurs de la Compassion, sous l’impulsion du chanoine Garrigou, président de l’A.A et ancien élève des sulpiciens. Autre exemple plus marquant encore : c’est à partir de 1828 que le père Chaminade, change les orientations de sa nouvelle congrégation, après la lecture d’un livre de Jean-Jacques Olier, dont il n’a jamais dévoilé le titre ; sans doute l’introduction à la vie et aux vertus chrétiennes.
Finalement, ce qui ressort plus particulièrement est le résultat inespéré de la « diaspora sulpicienne » du fait de la Révolution Française. Redémarrage de la fondation de Montréal, création de la fondation de Baltimore avec toutes les ramifications missionnaires à partir de là, une meilleure connaissance de l’œuvre de Saint-Sulpice en Europe occidentale. Suit une reprise assez rapide en France avec le Concordat de 1801 appuyée dans un second temps contrasté, par la reconnaissance officielle de la Compagnie sous l’impulsion Louis XVIII le 3 avril 1816. Non seulement des séminaires plus nombreux sont confiés à Saint-Sulpice, mais d’anciens élèves marqués par la spiritualité de l’Ecole Française évangélisent pour la nième fois la France, commençant souvent par grouper quelques laïcs, hommes ou femmes, pour fonder ou des cercles catholiques ou de nouvelles congrégations. Sans exagération, nous pouvons avouer que la renaissance catholique du 19ème est en grande partie animée par les intuitions de l’Ecole Française, même si pour une part elles semblent s’être coulées dans le sillage de l’ordre moral.
Source : Philippe Molac 2013
M. Philippe MOLAC, pss, historien de l’église, est supérieur de la maison provinciale rue du Regard à Paris et ancien doyen de la faculté de l’Institut catholique de Toulouse. Son livre le plus récent est Les Poèmes de l’Arcane de saint Grégoire de Nazianze (Perpignan : Artège, 2013).